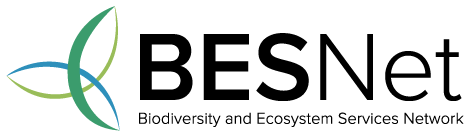La tribune des experts: Prudence Galega s’exprime sur la priorité accordée par le Cameroun à l'engagement des femmes dans la Biodiversité

"Quedas de água de Ekom Nkam" by carlosoliveirareis is licensed under CC BY 2.0.
"Quedas de água de Ekom Nkam" by carlosoliveirareis is licensed under CC BY 2.0.

Image courtesy of Prudence Galega
Image courtesy of Prudence Galega
Mme Prudence Galega a commencé sa carrière en tant que juriste, experte juridique, procureur et juge. Inspirée par son enfance passée dans les savanes des hauts plateaux, elle s'est orientée vers la politique environnementale et la biodiversité. Pendant plus de dix ans, elle a été conseillère politique et secrétaire permanente au ministère de l’Environnement du Cameroun. En outre, elle a été pendant des années le point focal national pour la CDB et la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique des Nations unies sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est aujourd'hui une experte clé pour la région africaine, accompagnant le GNA.

Image courtesy of Prudence Galega
Image courtesy of Prudence Galega
Mme Prudence Galega a commencé sa carrière en tant que juriste, experte juridique, procureur et juge. Inspirée par son enfance passée dans les savanes des hauts plateaux, elle s'est orientée vers la politique environnementale et la biodiversité. Pendant plus de dix ans, elle a été conseillère politique et secrétaire permanente au ministère de l’Environnement du Cameroun. En outre, elle a été pendant des années le point focal national pour la CDB et la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique des Nations unies sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle est aujourd'hui une experte clé pour la région africaine, accompagnant le GNA.

Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Entretien avec Prudence Galega, ancienne Conseillère politique et Secrétaire permanente au ministère de l’Environnement du Cameroun
Il y a quelques mois, le Cameroun a finalisé sa première évaluation nationale des écosystèmes avec le soutien de BES-Net. Il s'agissait d'un moment important pour un pays qui, avec son étendue physique considérable, se classe au quatrième rang des pays les plus riches en matière de biodiversité en Afrique. Aujourd'hui, l'évaluation des écosystèmes du Cameroun sert de base à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de biodiversité, des plans d'action et des cadres de financement, ainsi qu'à l'établissement de rapports à ce sujet. Elle est également largement utilisée comme référence dans d'autres pays en Afrique.
Madame Prudence Galega, Co-Présidente de l'équipe d'auteurs de l'évaluation nationale des écosystèmes du Cameroun, s'est révélée être une pionnière et une force motrice, non seulement pour ce projet, mais également pour la prise de décisions en matière de biodiversité et les négociations au Cameroun de manière générale. Lors de cette conversation franche avec BES-Net, elle se penche sur les ambitions et les attentes du Cadre mondial pour la biodiversité de l’après 2020 parmi les pays africains, sur la nécessité de décisions éclairées par la science et sur son propre rôle en tant que femme impliquée dans les négociations sur la biodiversité pour le Cameroun et le Groupe de négociateurs africains (GNA) à la Convention sur la diversité biologique.
Au cours de votre décennie d'expérience en tant que Conseillère politique et négociatrice, comment avez-vous été impliquée dans les discussions mondiales sur la biodiversité ?

Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Vous vous souviendrez qu'au début des années 1990, nous avons assisté à l'émergence d'un fort engagement envers l'environnement et d'une prise de conscience mondiale à cet égard. Cette tendance était particulièrement marquée dans les pays en développement, où elle constituait un pilier essentiel du développement durable. Toutefois, comme le montrent les résultats des recherches personnelles effectuées après l'adoption des conventions de Rio en 1992, très peu d'intérêt, au niveau national, a été accordé à l'élaboration d'un cadre juridique adapté pour l'environnement. Les résultats des recherches menées sous l'égide des représentants du Parlement ont montré qu'il existait une lacune importante dans l'élaboration d'une législation respectueuse de l'environnement. Ma recherche a déclenché un élan considérable avec des réseaux pour renforcer la représentation de l'environnement à la fois dans les Parlements au Cameroun et dans d'autres pays de la région de l'Afrique centrale.
Le succès et l'impact de ce travail de recherche ont contribué à mon détachement du ministère de la Justice et à ma nomination en 2009 en tant que Conseillère politique principal auprès du ministre de l’Environnement. L'un de mes premiers rôles fut d'être le point focal national du Cameroun pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et ses Protocoles (à l'époque, le Protocole de biosécurité). Après six ans de service, j'ai été nommée en 2007 Secrétaire Permanente et chargée de coordonner les aspects techniques du ministère de l’Environnement jusqu'en 2020. À ce moment-là, le chef de l'État m'a désignée pour diriger une nouvelle institution judiciaire dédiée à la documentation et à la formation des juges. Ce parcours m'a permis d'acquérir une vaste expérience et une grande reconnaissance tant au niveau national qu'international, et surtout au sein de la région, en ce qui concerne les questions de biodiversité.
Vous avez également siégé au GNA et avez récemment participé aux réunions des organes subsidiaires de la CDB tels que le SBSTTA-24/SBI-3/OEWG-3 et l'OEWG-4. Sur la base de votre expérience, quelles sont les attentes et les ambitions des pays africains à l'égard du Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020 ?

Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Mon engagement dans les négociations multilatérales a débuté au sein du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages du Plan stratégique 2010-2020 et des Objectifs D'aichi pour la biodiversité adoptée en 2010. Au cours de plus d'une décennie de service en tant que coordinatrice, négociatrice principale et actuellement experte de soutien au sein du GNA, il est apparu clairement que les pays africains signataires ont un fort engagement à garantir que les objectifs de conservation, d'utilisation durable, d'accès et de partage des avantages, tels qu'ils ont été convenus dans le cadre de la CDB, soient atteints de manière équilibrée. L'Afrique abrite les forêts les plus intactes à l'échelle mondiale et est dotée de ressources naturelles inestimables qui offrent un grand potentiel pour soutenir les efforts de la région en vue de réduire la pauvreté de manière durable et de favoriser le développement.
À l'instar d'autres pays signataires, les pays africains reconnaissent leurs faibles performances dans la réalisation des objectifs d'Aichi, et la tendance à la perte de biodiversité au cours des dernières décennies a donc continué à s'accentuer. La plupart des délégués africains sont des points focaux nationaux pour leur pays, chargés d'élaborer et de contrôler leurs plans d'action nationaux en matière de biodiversité et de stratégie. Confrontés à des expériences difficiles dans la mise en œuvre de ces documents politiques, les membres du GNA se considèrent comme des acteurs clés pour façonner l'ambition mondiale de ralentir la courbe de la perte de biodiversité d'ici à 2030. Le GNA s'est donc pleinement engagée dans les négociations au sein du SBSTTA, du SBI et de l'OEWG jusqu'à présent.
Bien que le GNA reconnaisse la diversité des situations nationales dans les régimes des aires protégées, une convergence croissante s'observe à travers le soutien des Ministres de l'environnement africains en vue d'établir un consensus quant à l'objectif de conservation 30/30 proposé. Cet objectif repose sur des conditions claires visant à prendre en considération les circonstances nationales, d'autres mesures de préservation incluant des approches communautaires, ainsi que l'accent mis sur la garantie de l'adéquation des engagements financiers à l'ambition fixée. Au sein de ce groupe régional, les négociations offrent l'opportunité de veiller à ce que les trois piliers de la Convention soient abordés de manière équilibrée au sein des objectifs, des cibles et des moyens de mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
Le GNA soutient que les objectifs d'Aichi n'ont pas été atteints principalement en raison d'un manque de moyens de mise en œuvre et de financement. Des études récentes mettent en évidence un coût estimé de 700 à 800 milliards de dollars US par an nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du GBF, ainsi qu'un besoin urgent d'augmenter le financement de la biodiversité. Ces constatations ont éclairé les positions des parties africaines aux négociations sur les différentes sources de flux financiers nécessaires (à la fois publics/privés et internationaux/nationaux). Les parties africaines ont souligné la nécessité de se conformer aux articles 20 et 21 de la Convention, qui déterminent la responsabilité des parties développées envers les parties en développement au sein de la CDB.
Tout en mettant l'accent sur une augmentation significative des flux internationaux, le GNA a appelé à une augmentation du financement national de la biodiversité de 1 % du PIB.
En complément du FEM, l’Afrique ainsi que d'autres pays en voie de développement ont avancé une proposition importante en faveur de l'établissement d'un fonds dédié à la biodiversité. Une telle mesure revêt une importance capitale afin de garantir que les priorités en matière de biodiversité du GBF bénéficient d'un financement adéquat sur le continent africain.
Deuxièmement, l'utilisation d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices générés par l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées peuvent contribuer de manière significative à combler le déficit actuel en ressources de biodiversité. Bien que ces débats suscitent des controverses, il demeure impératif que l'Afrique dispose d'un engagement mondial envers un cadre de biodiversité assorti des moyens requis pour sa mise en œuvre effective.
Comment percevez-vous la valeur des réseaux tels que le nôtre et l'effort visant à partager les connaissances en matière de conservation de la biodiversité ?

Image by Anja-#pray for ukraine# #helping hands# stop the war from Pixabay
Image by Anja-#pray for ukraine# #helping hands# stop the war from Pixabay
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'expansion exponentielle des partenariats que j'ai pu observer avec BES-Net et UNEP-WCMC. Cela a commencé il y a six ans, au moment où le Cameroun débutait son évaluation nationale des écosystèmes. Ce processus m'a offert l'opportunité de mettre en œuvre mon expertise dans la réalisation d'évaluations portant sur la valeur et l'état de la biodiversité, des écosystèmes ainsi que des moteurs du changement. De plus, j'ai eu le privilège de coordonner les activités d'une équipe d'experts en biodiversité renommés. Cette collaboration m'a également permis d'accroître mes compétences en matière de synthèse de données et d'informations, ainsi que de participer à plusieurs dialogues constructifs.
Plus précisément, la série de trilogues BES-Net organisés au cours de l'évaluation a suscité un niveau élevé d'engagement parmi les experts scientifiques et les acteurs politiques. Une innovation importante dans ce processus qui a apporté des perspectives précieuses pour mes travaux futurs a été l'intégration des connaissances scientifiques et autochtones dans les résultats de la recherche. Le fait d'axer les dialogues sur les défis nationaux en matière de développement, tels que les liens entre l'alimentation, la santé et la sécurité de l'eau, a également permis de réorienter le travail, d'identifier et de mener l'évaluation, et de générer les informations nécessaires pour répondre aux questions politiques clés définies comme des priorités nationales dans l'évaluation.
De manière plus significative, BES-Net a soutenu le partage des connaissances sur le processus et les premiers résultats de l'évaluation de l'écosystème national du Cameroun. Il a également soutenu la capitalisation des résultats de la recherche et la contribution active des délégués et experts camerounais dans les négociations à différents niveaux.
Ce soutien a grandement influencé les dialogues et les processus d'élaboration des politiques au sein de la Commission des forêts d'Afrique centrale, du SBSTTA, du SBI et, actuellement, au sein de l'OEWG dans le cadre des négociations en cours pour un GBF, où certains auteurs de l'évaluation de l'écosystème camerounais sont des acteurs clés.

Photo by Jonathan Mabey on Unsplash
Photo by Jonathan Mabey on Unsplash
Que pensez-vous de la façon dont les femmes sont représentées et font entendre leur voix dans des discussions mondiales comme celle-ci ?

Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Photo by Edouard TAMBA on Unsplash
Parfois, je me trouve dans une situation paradoxale. Au Cameroun, les femmes ont joué le rôle d'expertes politiques dans de nombreuses négociations ; mon prédécesseur et mon successeur sont toutes deux des femmes. Le paradoxe réside dans le fait qu'au même moment où les femmes reçoivent une reconnaissance en tant que leaders dans des processus mondiaux et nationaux de haut niveau, la représentation des priorités des jeunes filles et des femmes en ce qui concerne la biodiversité demeure relativement faible. La Stratégie Nationale et le Plan d'Action pour la biodiversité du Cameroun ont opté pour la participation et l'implication des femmes en tant que priorité, mais cela se limite là – cela est resté en grande partie au niveau de la planification politique.
Les femmes peuvent apporter une contribution importante à ce processus, que ce soit au niveau de l'élaboration des politiques, où je me trouve, au niveau de la mise en œuvre ou au niveau local, où elles interagissent directement avec la biodiversité. Par exemple, les femmes des communautés indigènes préservent les semences naturelles de diverses cultures, alors que la plupart des semences utilisées pour la production industrielle sont généralement modifiées. Là encore, ce sont souvent les femmes qui conservent le savoir sur la valeur des graines et des plantes pour les besoins quotidiens en matière de nutrition et de santé, mais ce savoir n'est souvent pas reconnu, même dans les recherches qui en tirent parti.
Au Cameroun, les femmes représentent plus de la moitié de la population et les femmes des communautés locales dépendent largement de la biodiversité pour soutenir les économies rurales et le bien-être des ménages. Cependant, les voix des femmes, qui devraient être davantage prises en compte dans les processus d'élaboration des politiques et de prise de décision, ne sont souvent pas représentées. L'application du principe de participation à l'élaboration des politiques en matière de biodiversité et d'environnement a été principalement le fait d'approches sporadiques qui ne tiennent pas compte de la voix des femmes.
Quels sont les aspects du débat mondial sur la biodiversité qui vous inspirent aujourd'hui et vous poussent à aller de l'avant ?

©Leonor Erea from Getty Images via Canva.com
©Leonor Erea from Getty Images via Canva.com
Mon inspiration vient de ma connexion instinctive avec la nature. Je suis inspirée lorsque je pense à la situation dans laquelle nous nous trouvions au moment de l'adoption des conventions de Rio dans les années 90 et au chemin parcouru aujourd'hui. Reconnaître les progrès réalisés au cours des dernières décennies du point de vue de la gouvernance me donne de l'espoir et l'élan nécessaire pour aller de l'avant. J'ai quitté le ministère de l’Environnement pour revenir à mon Ministère d'origine, le ministère de la Justice, mais je continue à percevoir le lien entre la justice et l'environnement. Je m'engage à rester, à servir continuellement en tant qu'acteur clé dans la défense juridique de la nature et la sécurité environnementale des générations à venir.